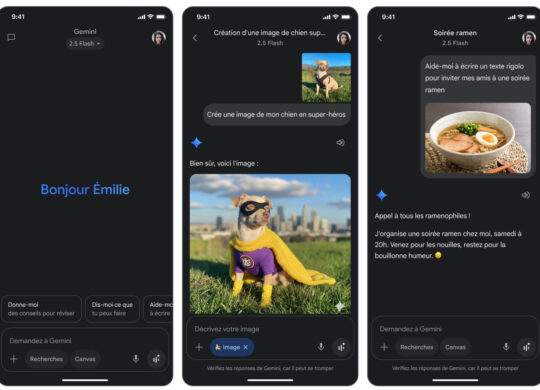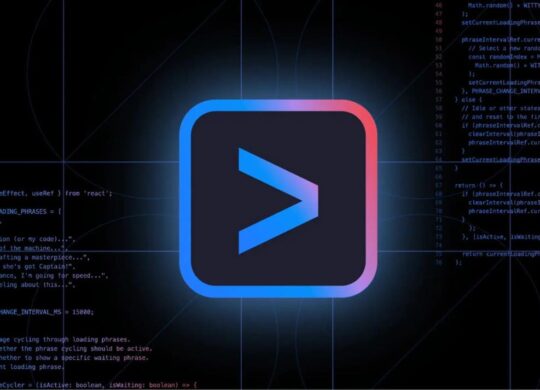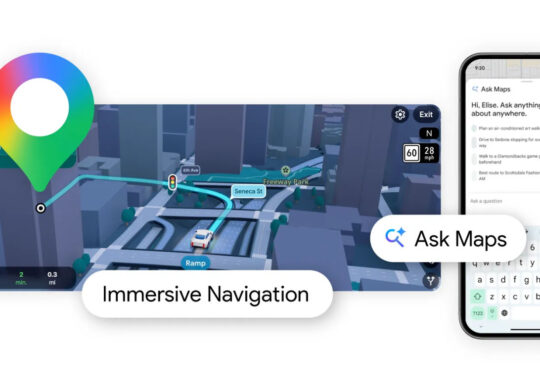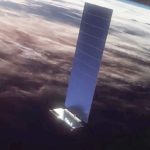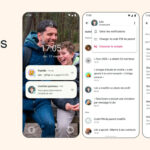L’idée d’une intelligence artificielle peu gourmande séduit autant qu’elle divise. À mesure que les assistants génératifs s’installent dans les usages du grand public et des entreprises, une question revient avec insistance : quel est leur véritable coût environnemental ? Google a récemment communiqué des estimations très faibles pour une requête adressée à Gemini, son IA générative. Mais une analyse publiée par le chercheur néerlandais Alex de Vries-Gao vient bousculer ce récit, en soulignant que la réalité dépend fortement du périmètre de calcul et que, à l’échelle mondiale, l’addition pourrait déjà atteindre des niveaux comparables à ceux d’une grande métropole.
Le débat ne porte pas uniquement sur des chiffres. Il met en lumière une difficulté centrale : mesurer l’impact d’un service numérique n’est pas la même chose que mesurer l’impact d’un écosystème. Une requête isolée, évaluée dans un centre de données optimisé, peut afficher une empreinte faible. Mais multipliée par des milliards d’utilisations, intégrée à des chaînes de production logicielle, et alimentée par un mix électrique variable selon les régions, l’empreinte totale change de dimension. C’est précisément cette différence d’échelle et de méthode qui alimente aujourd’hui la controverse.

Google publie une estimation « par requête » pour Gemini
Dans une publication technique diffusée à l’été 2025, Google a détaillé une méthode de mesure centrée sur l’inférence, c’est-à-dire la phase où le modèle répond à un prompt. L’entreprise y avance des ordres de grandeur visant à quantifier l’eau et l’électricité nécessaires pour générer une réponse. Selon ces estimations, une requête typique demanderait environ 0,24 wattheure d’électricité, mobiliserait 0,26 millilitre d’eau et produirait environ 0,03 gramme d’équivalent CO2.
Présentés ainsi, ces chiffres suggèrent une consommation limitée, loin de l’image d’un « monstre énergétique ». L’intérêt de cette approche est réel : elle fournit des repères concrets, susceptibles d’être suivis dans le temps, et elle incite à documenter les progrès d’optimisation (matériel plus efficace, modèles mieux compressés, allocation des ressources, etc.). Pour un acteur industriel, disposer d’un indicateur standardisé facilite aussi le pilotage interne et la comparaison entre générations de systèmes.
Le périmètre de calcul, point clé de toute comparaison
Ces métriques n’ont toutefois de valeur qu’en fonction de ce qu’elles incluent. Une mesure par requête peut être strictement rattachée au centre de données (énergie consommée par les serveurs et le refroidissement), sans forcément intégrer certains effets indirects : production de l’électricité en amont, consommation d’eau associée à cette production, réseau, ou encore amortissement des infrastructures. De plus, les résultats peuvent varier selon la région, la saison, la température extérieure ou les choix techniques (refroidissement par air, par eau, réutilisation d’eau, etc.).
En clair : une estimation sur Gemini n’est pas automatiquement transposable à tous les usages de l’IA, ni à tous les opérateurs, ni à toutes les zones géographiques. Elle décrit un scénario précis, dans un contexte donné, avec une méthodologie déterminée.
Une contre-analyse élargit l’échelle aux systèmes d’IA dans leur ensemble
Alex de Vries-Gao, affilié à l’Institut d’études environnementales de l’Université Vrije d’Amsterdam et connu pour ses travaux sur l’impact énergétique des infrastructures numériques, propose une lecture radicalement différente. Dans un article de la revue scientifique Patterns, il ne cherche pas à estimer le coût d’une requête isolée. Il tente plutôt d’approcher l’empreinte annuelle de l’ensemble des systèmes d’IA, en s’appuyant sur des indicateurs de reporting environnemental et sur des données publiques disponibles.
Ses estimations placent l’empreinte carbone des systèmes d’IA en 2025 dans une fourchette comprise entre 32,6 et 79,7 millions de tonnes de CO2, un niveau rapproché de celui des émissions d’une grande ville comme New York. Sur le volet hydrique, la consommation est évaluée entre 312,5 et 764,6 milliards de litres, une quantité mise en parallèle avec des ordres de grandeur proches de la consommation annuelle d’eau en bouteille.
La différence avec les chiffres de Google est donc moins une contradiction frontale qu’un changement de focale. D’un côté, une micro-mesure centrée sur un usage. De l’autre, une macro-estimation visant à capturer l’addition mondiale d’un secteur en pleine accélération.
L’eau, le nœud du désaccord entre consommation directe et impacts indirects
La critique la plus structurante porte sur la manière de comptabiliser l’eau. Les estimations industrielles centrées sur les centres de données retiennent souvent l’eau utilisée directement pour le refroidissement. Or, l’étude de De Vries-Gao insiste sur un point : l’empreinte hydrique de l’IA ne se limite pas à l’eau consommée sur site. Elle inclut aussi, potentiellement, l’eau déplacée dans la chaîne énergétique, notamment dans la production d’électricité.
Pourquoi l’empreinte hydrique peut se déplacer en amont
Dans de nombreux systèmes électriques, produire davantage d’énergie implique des installations qui utilisent elles-mêmes de l’eau : refroidissement de centrales, processus industriels, ou contraintes propres au type de production (thermique, nucléaire, etc.). Même lorsque les centres de données limitent leur consommation d’eau directe, ils peuvent accroître la demande globale d’électricité, et donc indirectement augmenter l’empreinte hydrique associée à la génération de cette énergie.
C’est un mécanisme fréquent dans l’évaluation environnementale des services numériques : réduire un poste visible (par exemple l’eau sur site) ne garantit pas que l’empreinte globale baisse dans les mêmes proportions si d’autres postes, moins visibles, augmentent ailleurs. L’étude plaide ainsi pour une lecture plus complète, intégrant les effets indirects, afin d’éviter des conclusions excessivement optimistes.
Des estimations nuancées, mais un appel clair à plus de transparence
L’auteur de la contre-analyse ne présente pas ses résultats comme une mesure parfaite. Il souligne au contraire que la précision dépend des données accessibles, souvent agrégées, hétérogènes ou incomplètes. Les entreprises publient des informations environnementales, mais la granularité varie : certains chiffres sont consolidés à l’échelle d’un groupe, d’autres sont exprimés en ratios, et les hypothèses de conversion ne sont pas toujours comparables. Cette opacité rend difficile l’établissement d’un bilan universel et vérifiable.
Dans ce contexte, l’étude encourage les autorités à demander davantage d’informations et à renforcer les obligations de reporting, de façon à distinguer clairement ce qui relève de l’inférence, de l’entraînement, de la consommation réseau, et des impacts indirects liés à la production d’énergie. Le sujet devient d’autant plus sensible que l’IA est désormais perçue comme une infrastructure stratégique, au même titre que le cloud ou les télécommunications.
Un contexte européen paradoxal pour le reporting environnemental
Cette demande de transparence intervient alors que l’Europe discute simultanément de simplifications réglementaires visant à alléger certaines contraintes de déclaration en matière de durabilité pour une partie des entreprises. L’objectif affiché est de réduire la charge administrative et de soutenir la compétitivité. Mais dans le domaine de l’IA, où l’impact réel dépend fortement de paramètres techniques et énergétiques, le risque est de disposer de moins de données au moment même où les usages explosent.
Pour les observateurs, l’enjeu n’est pas de choisir entre innovation et environnement, mais de se doter d’outils de mesure robustes. Sans indicateurs homogènes, la comparaison entre acteurs reste fragile, et les promesses de sobriété sont difficiles à vérifier.
Vers des standards de mesure plus crédibles pour l’IA générative
Au-delà du cas Gemini, l’épisode illustre la nécessité d’un cadre commun. Les mesures à l’échelle de la requête sont utiles pour suivre les progrès internes d’un service, mais elles ne décrivent pas, à elles seules, l’effet systémique d’une généralisation massive de l’IA. À l’inverse, les estimations globales donnent un ordre de grandeur, mais elles reposent sur des hypothèses et sur la disponibilité de données publiques, encore inégales.
Dans les prochains mois, la pression pourrait augmenter pour standardiser les périmètres : séparer clairement l’empreinte de l’entraînement et celle de l’inférence, publier des facteurs d’émissions contextualisés par région, détailler la stratégie de refroidissement et les sources d’énergie, et rendre plus transparent le volume de calcul réellement mobilisé. À mesure que l’IA devient une couche logicielle omniprésente, ces indicateurs pourraient s’imposer comme des références, au même titre que les labels d’efficacité énergétique dans d’autres secteurs.
Une chose est certaine : l’empreinte environnementale de l’IA ne se résume pas à un chiffre unique. Entre communication industrielle, exigence scientifique et contraintes réglementaires, l’enjeu des prochaines années sera d’obtenir des mesures comparables, vérifiables et compréhensibles, afin que la course à l’intelligence artificielle ne se fasse pas à l’aveugle sur son coût réel.